Chap 28
Zorobabel, Forêts de mythes
par Muriel Andrin, ULB, juillet 2017
Lieux de la création sensible et d’expériences esthétiques, les films d’animation foisonnent aujourd’hui et élargissent leurs frontières au travers de nouvelles pistes de réflexion. Alimentant les possibilités de la déconstruction narrative ou de nouveaux liens avec le réel, les expérimentations plastiques et les constantes réinventions de son identité, le cinéma d’animation permet surtout d’interroger le cinéma lui-même, l’invitant « à faire un retour sur sa propre histoire, à proposer de nouveaux aménagements de perspectives et d’inédits agencements mobiles dans son temps et son espace ».[1] L’atelier Zorobabel répond très clairement à l’idée de s’inscrire dans ce questionnement sur le cinéma au travers de l’animation, mais répond aussi, dans ses multiples pratiques aux ambitions des ateliers de production de « promouvoir la recherche et l’expérimentation sur le plan technique et esthétique, valoriser l’originalité et l’authenticité des sujets, valoriser la création, aussi bien dans l’écriture que dans la réalisation ».[2]

Les grenouilles, Delphine Renard (1998)
Si Zorobabel devient un atelier de production subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles en avril 2012, venant élargir les perspectives mises en place par l’atelier d’école de La Cambre et des ateliers de production Camera-etc, et Graphoui concernant le cinéma d’animation, il est en réalité loin de naître à ce moment précis ; au moment de son intégration dans le cercle très sélectif des ateliers de production, ses premières activités remontent en réalité déjà à plus de 18 ans. En 1994, Delphine Renard et William Henne mettent sur pied un atelier d’initiation pour enfants, adolescents et adultes dans le cadre de l’éducation permanente. Si cette idée persiste encore aujourd’hui, très vite, des films d’auteurs, individuels et communs, sont également et parallèlement mis en chantier. En 1997, l’Atelier Collectif voit le jour permettant à des adultes de créer des courts métrages d’animation dans des conditions professionnelles. Delphine Cousin, rejoint l’équipe en 2002 ; en 2010, ce sont deux animatrices qui font leur entrée – Caroline Nugues et Marie Vella – pour dispenser des cours du soir. Les ateliers d’initiation du CEC garantissent une ouverture à la diversité et à la mixité culturelle ; les projets sont proposés en fonction de contraintes (d’ordre narratif, plastique, thématique). L’évolution de la création se fait aussi en parallèle à celle des technologies, le 16mm étant progressivement remplacé par l’informatique. Loin de créer en vase clos, Zorobabel remplit pleinement l’ambition d’être une passerelle entre l’école et le milieu professionnel ; en partenariat avec Camera-etc., l’appel à projet START sélectionne et soutient en effet la production de premiers films de 5 minutes minimum (ou 10 minutes maximum) de jeunes cinéastes (résidents en Fédération Wallonie-Bruxelles ou belges francophones s’ils résident ailleurs) au sortir des écoles, mais dans une recherche constante d’innovation.
Coexistent dès lors au sein de ce jeune atelier tout à la fois des films d’auteurs, des films collectifs (coordonnés par William Henne) mais aussi des films d’initiation à l’animation. On pourrait, dans ce cadre, aisément assister à un éclatement des formes et des perspectives ; pourtant, malgré la diversité grandissante, les films produits par Zorobabel sont traversés par des idées récurrentes, des échos (thématiques, plastiques) qui s’articulent toutefois toujours selon les particularités et la personnalité de chacun. La ligne de fond qui génère le ciment commun tient très clairement de rencontres entre l’animation et d’autres formes artistiques et médiatiques.
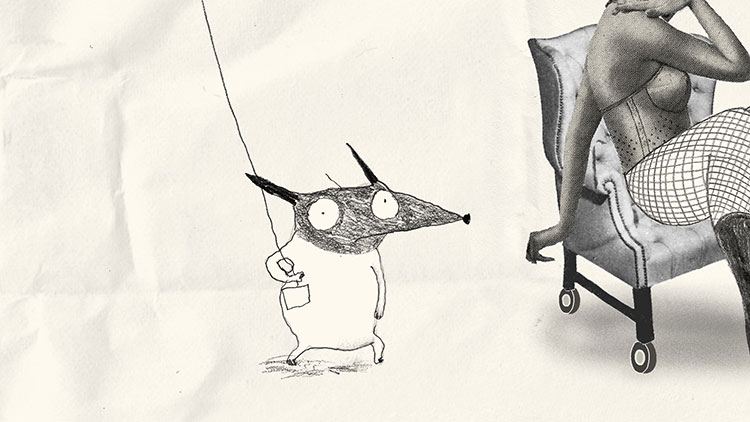
Caniche, Noémie Marsily et Carl Roosens (2010)
Cette vision du cinéma comme point de rencontre ou d’assimilation de différentes formes artistiques n’est bien évidemment pas neuve. Elle hante les discussions théoriques dès les premières années ; dans cet esprit, le cinéma est défini dès 1911 par Ricciotto Canudo comme une synthèse des « rythmes de l’espace » (architecture, peinture et sculpture) et des« rythmes du temps » (poésie et musique), un résumé des autres arts qui fait converger deux tendances réciproques : « arts plastiques en mouvement rythmique, arts rythmiques en tableaux et en sculptures de lumières ».[3] Dans un article de 1926, le formaliste russe Boris Eichenbaum assigne le terme de syncrétisme à ces pratiques au croisement de plusieurs lignées artistiques, à cette forme « fondant en elle différents arts » :
« L’évolution de l’art, en tant qu’entité, s’exprime dans des oscillations permanentes entre l’isolement (différenciation) et fusion. Chaque art pris en particulier existe et se développe par rapport aux autres, comme espèce particulière et comme variété. Selon les époques, tantôt un art, tantôt un autre, tend à être un art de masse et, inspiré par le souffle du syncrétisme, vise à englober les éléments des autres arts ».[4]
Le syncrétisme, au départ du cinéma, est clairement induit par une volonté de rendre légitime cette nouvelle forme (qui ne sera considérée comme artistique qu’au cours des années 20) au travers de son association avec des formes majeures comme le théâtre, la littérature ou la musique. Mais progressivement, au fur et à mesure de son essor international, le cinéma s’éloigne de son sentiment d’infériorité culturelle et redéfinit la cartographie des pratiques artistiques et de l’histoire de l’art ; il« ne défie plus juste la peinture de façon isolée mais plutôt tout le système des arts, révélant la possibilité de nouvelles configurations, hiérarchies, alliances et hostilités ».[5]

Tango Nero, Delphine Renard (2005)
Les débats menés à l’époque ont laissé de nombreuses traces, jusqu’à l’époque actuelle, produisant quasi systématiquement de nouvelles pistes terminologiques (les notions d’hybridation, remédiation, métissage, recyclage, croisement succèdent ainsi au syncrétisme) ; l’extension du cinéma hors de ses murs, mais aussi le mélange constant des pratiques artistiques dans un décloisonnement novateur tend aussi à l’éclatement des formes et à une redéfinition constante du paysage artistique. L’animation s’inscrit, par essence, dans ces questionnements, trouvant ses racines dans une association entre dessin et image en mouvement, et cela bien avant la naissance du Cinématographe.
Il n’est donc pas surprenant de voir les différentes formes de l’animation produites par l’atelier Zorobabel s’approprier les spécificités d’autres arts ou étendre le champ d’autres pratiques; au-delà de la bande dessinée (avec qui l’animation entretient par ailleurs des liens ontologiques), les films dialoguent avec la peinture, mais aussi la musique, la danse…voire le cinéma documentaire dans des interactions continuelles et infiniment variables. Loin de la simple illustration de texte, le film Les grenouilles de Delphine Renard (1998) dialogue avec les paroles d’une chanson de Steve Waring, nourrissant l’émerveillement d’un enfant (et des spectateurs) face à ces animaux fantastiques et à leurs personnalités; la danse (prétexte parfait à la mise en mouvement des corps et des objets), rythme le récit de Tango Nero de Delphine Renard (2005) – une animation picturale qui accompagne le parcours d’une jeune femme en voyage à Venise, et qui, témoin d’un vol de rubis, partage une danse avec le voleur après avoir avalé le bijou; imaginé dans le sillon d’un spectacle de danse de Karine Pontiès (« Holeulone »), Heureux ! de Thierry Van Hasselt (2007) fait de sa technique de peinture sur verre (qui ressemble à de la pellicule brûlée) un perpétuel mouvement éphémère, entre apparition et dissolution des corps et des paysages.
Mais ce dépassement dans un jeu des frontières s’étend largement au-delà des associations traditionnelles de l’interdisciplinarité avec les arts plastiques et s’engage dans une série d’autres rencontres, répondant à la volonté postmoderne de décloisonner à la fois les pratiques mais aussi les identités. Ainsi, il faut également considérer l’existence de cet atelier de production comme une brèche ouverte vers un lieu de syncrétisme ou, d’un point de vue plus contemporain, de l’intermédialité. Apparu dans les années 80, le concept permet d’étendre le champ de l’intertextualité pour témoigner de la rencontre entre les médias. La définition du terme est proposée par Silvestra Mariniello, « on entend l’intermédialité comme hétérogénéité; comme conjonction de plusieurs systèmes de communication et de représentation; comme recyclage dans une pratique médiatique, le cinéma par exemple, d’autres pratiques médiatiques, la bande dessinée, l’Opéra comique etc.; comme convergence de plusieurs médias; comme interaction entre médias; comme emprunt; comme interaction de différents supports; comme intégration d’une pratique avec d’autres; comme adaptation; comme assimilation progressive de procédés variés; comme flux d’expériences sensorielles et esthétiques plutôt qu’interaction entre textes clos; comme faisceau de liens entre médias ».[6]

La Chair, Louise Lemoine-Torrès et William Henne (2014)
L’intermédialité chez Zorobabel permet de continuer à explorer les dimensions plus traditionnelles des rapports avec la littérature, comme au travers de l’univers du conte dans Barbe Bleue en 2010 ou du Tokyo de 1868 dans Otomi (2006) réalisé à partir de la nouvelle de Ruynosuke Akutagawa. Avec La Chair (2014), Louise Lemoine-Torrès et William Henne se lient eux aussi à la littérature, adaptant une nouvelle éponyme écrite par la comédienne. Fruit d’une coproduction avec le studio de production français Lardux, La Chair entraîne définitivement l’atelier vers une vision à la fois adulte et transgressive des possibilités de l’animation. Le film nous confronte à un monde d’anticipation où les corps hyper-sexualisés mais aussi déshumanisés de femmes sans tête – la chair – servent au plaisir des hommes et en particulier du personnage principal, Mr Xeu. Mais d’autres films naissent de la rencontre à d’autres supports ou d’autres formats. En 2005, l’Atelier Collectif signe Transit qui s’inscrit dans la pratique documentaire au travers de témoignages de réfugiés ; le Collectif réalise aussi le clip Kill the Surfers pour le groupe belge Ghinzu (2009) puis un reportage animé dans L’affaire Ghinzu (2010); Pigmaleón mélange une marionnette-réalisateur et une poupée photoréaliste qui s’anime (la danseuse Emmanuelle Vincent de la compagnie t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e), image par image, sous sa volonté pour entamer avec lui une chorégraphie ; Noémie Marsily et Carl Roosens s’inspirent d’une chanson de Carl et les hommes-boîtes pour composer l’univers foisonnant d’Autour du lac (2013) ; Kijé, devient un livret illustré, produit par Zorobabel et Graphoui, accompagnant le DVD du film. De façon plus générale, l’idée de configurations protéiformes tient aussi de partenariats développés avec le Musée d’Ixelles et le Wiels à Forest.
L’identité des cinéastes participe elle aussi à ce décloisonnement « vivifiant et contemporain » (pour reprendre les mots avancés par les membres de l’atelier) et l’extension des pratiques. Se distinguant de l’héritage traditionnel de l’animation et de ses formations, la plupart des cinéastes de Zorobabel, ces « acrobates polyvalents »»[7],présentent ainsi des parcours pluriels leur permettant d’échapper à toute catégorisation facile. S’il est cinéaste et producteur, fondateur avec Delphine Renard de Zorobabel, William Henne est aussi auteur de bandes dessinées et a publié une douzaine de livres et plusieurs courts récits ; tout comme Delphine Cousin (pour une formation en arts plastiques), Delphine Renard a fait ses études à l’ERG (Ecole de Recherche Graphique de Bruxelles) où elle a étudié l’animation mais aussi la vidéo ; Noémie Marsily publie des bandes dessinées et fait partie d’un collectif (Nos restes) qui expérimente autour du livre, de la narration, des images ; Carl Roosens qui a lancé ce même collectif (en 2007), réalise des vidéos et est le chanteur d’un groupe musical, Carl et les Hommes-boîtes ; en dehors de ses activités de dessinatrice (et de musicienne puisqu’elle a signé la musique de son film Kijé), Joanna Lorho enseigne la narration à l’ERG ; Louise-Lemoine Torrès est actrice et auteure française ; Thierry Van Hasselt est dessinateur et narrateur (co-fondateur des éditions Fréon puis Frémok, structure engagée dans le cadre de projets pluridisciplinaires avec la danse, le théâtre, la musique), etc. Elles et ils sont réalisateurs, vidéastes, musiciens, dessinateurs ; tous redéfinissent constamment leur statut artistique, brouillant souvent de façon subtile les pistes critiques voire la réception du spectateur.
Cette capacité à se nourrir d’autres influences permet finalement à chaque film de devenir unique ; un élément visuellement, narrativement signifiant, et surtout immédiatement reconnaissable. Quelque part, se dessine ici l’idée que ces films articulent la représentation de l’imaginaire dans une vision très personnelle. « L’homme a toujours eu le désir de conserver des traces de lui-même » explique Isabelle De Maison Rouge :
« Aujourd’hui, plus que jamais, l’artiste met en œuvre cette aspiration. Il collecte et accumule des objets ou images qui parlent de lui et racontent son histoire. A l’aide de fictions ou de documentaires, il bâtit ses mythologies personnelles et nous les livre sans pudeur ».[8]

Le drapeau, Olivier Navez (1997)
Utilisé pour la première fois en 1964 dans le cadre d’une exposition au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris sous l’appellation« Mythologies quotidiennes », le terme devient en 1972« Mythologies individuelles » grâce à Harald Szeeman, et délimite un monde dans lequel chacun pose les signes et les signaux exprimant son monde personnel, englobant des formes très différentes. Isabelle De Maison Rouge propose quant à elle la variation« Mythologies personnelles » qui« exprime la transposition du quotidien par l’individu pour atteindre le personnel, c’est-à-dire l’intime ».[9] Le mythe, comme l’a déjà proposé Roland Barthes, n’est ni un objet, un concept, une idée, mais bien un mode de signification, une forme. Ainsi, plutôt que d’accumuler des objets personnels comme dans l’art contemporain, les cinéastes de Zorobabel traduisent leurs mythologies intérieures respectives en récits animés – chaque trait, chaque ligne, chaque narration définissant minutieusement les contours de ces mythologies de façon humoristique ou plus lyrique. Aucun narcissisme ici mais bien une ouverture directe vers une représentation d’un espace mental, physique ou émotionnel. Mais ces mondes ne sont pas pour autant refermés sur eux-mêmes ; les mythologies personnelles deviennent en réalité collectives – l’imaginaire d’un.e seul.e rencontrant, voire cristallisant soudain celui des spectateurs car« parler de mythologie personnelle dans le domaine artistique revient à tenir compte des interrogations que pose l’artiste à la société dans laquelle il vit ».[10]
Comme le souligne le Bilan de l’Atelier après 20 ans d’existence, « La spécificité de l’animation permet aux réalisateurs de s’exprimer de manière symbolique. Ils peuvent ainsi aborder le réel par le biais de l’imaginaire »[11] ; l’imaginaire, ce langage symbolique universel « à travers lequel nous donnons forme à des émotions, des images, des idées, des actions en usant précisément de ses caractéristiques fascinantes et déroutantes ».[12] Plus encore,« L’imaginaire est moins un domaine ou un territoire psychique propre qu’un mode de représentation qui se différencie du rationnel, de l’abstraction, du signe univoque, de l’identité et de la non-contradiction, de la connexion forte, de la démonstration et de la preuve, des classifications stables, etc. ».[13]
Certains films construisent ainsi, plan à plan, film par film, des mythologies personnelles ; des univers graphiques spécifiques s’imposent et dévoilent leurs propres règles, leurs propres architectures, souvent fantasmatiques. Dès lors, ce qui frappe par exemple dans le travail de Johanna Lorho ou Noémie Marsily et Carl Roosens, c’est leur immédiate familiarité, mais aussi leur capacité, pour ces mondes minuscules, à nous projeter dans une autre constellation dès le premier plan ou le premier dessin. Zorobabel s’impose dès lors comme le lieu où les cinéastes trouvent une place, un espace et le temps pour minutieusement élaborer leurs mondes.
Dès les premiers films produits, la création dépasse de loin l’univers traditionnel de l’animation pour s’engager sur d’autres voies plus complexes et inter-médiales. Le drapeau d’Olivier Navez (1997) s’inscrit ainsi dans les pas de Raoul Servais, en affichant un engagement politique derrière une esthétique qui frôle l’explosivité d’un Bill Plympton. Sur des fonds colorés, une animation aux traits noirs et comme bousculée, nous confronte à la montée en puissance du nationalisme qui écrase dans l’œuf toute résistance possible et visible, aussi ironique soit-elle. Le massacre d’un chien qui a uriné sur le drapeau érigé, le discours fascisant d’un homme politique qui prône le retour de la guillotine, le défilé d’hommes du pouvoir, un enfant qui fait le salut hitlérien. Seule une caméra de télévision, premier indice de cette pratique inter-médiale, capte cette dérive totalitaire… jusqu’à ce que le dirigeant mette la main devant l’objectif et obscurcisse toute possibilité d’avenir. Mais l’envahissement ne se limite pas au monde animé et investit la réalité ; le film se termine sur quelques plans photographiques de Bruxelles en noir et blanc où apparaît sur les murs, comme une ombre qui plane, le drapeau au triangle vert inversé. Le monde a basculé.

La forêt tropicale, 6 enfants entre 7 et 11 ans (1996)
Cette double perspective, du réel et de l’animation, offre un nouveau type de langage, l’un nourrissant l’autre de son identité et de ses forces. Cette approche apparaît ainsi dans La forêt tropicale (1996) qui ouvre la voie à la pratique du détournement et à celle de la réappropriation parodique du collage surréaliste ou situationniste. Si la voix off, les sonorités musicales et une carte épinglée au mur nous introduisent dans l’extraordinaire d’une forêt tropicale, les images nous dévoilent le quotidien d’un appartement en apparence passe-partout, sans habitants visibles. Mais la voix off finit par contaminer l’imaginaire visuel et le spectateur assiste à la transformation de l’espace en jungle dans un processus de pixilation, les objets du quotidien se métamorphosant en animaux aux mouvements étranges et syncopés. Surgissent d’étranges et merveilleuses scènes où l’eau qui s’échappe du pommeau de douche renvoie à la pluie tropicale, le tire-bouchon épouse les mouvements d’une grenouille femelle, un tuyau en aluminium joue les boa qui avale ses proies, les parapluies noirs se transforment en chauve-souris qui volent puis rejoignent leurs arbres pour dormir, une série de brosses incarnent des fourmis et l’on entraperçoit le chat qui joue, le temps d’une seconde, les pumas dans les sous-bois.

Va dans ta chambre, Caroline Nugues et Marie Vella (2009)
La contamination entre le réel et l’animation continuera à s’inscrire dans de nombreux films, comme une réflexion perpétuelle sur les transformations possibles de l’animation traditionnelle (au même titre que dans d’autres ateliers, comme Graphoui). Des témoignages réels, notamment de jeunes publics lors des ateliers d’initiation, génèrent littéralement les images et engendrent ainsi des propositions visuelles hybrides et joyeuses ; ce sont les enfants de 6 à 13 ans de la Maison de quartier Saint-Antoine à Forest qui parlent de leur pays d’origine dans Pourquoi je suis venu en Belgique (2000), d’autres enfants qui évoquent leur rapport à la classe dans Mon école ton école (2005) ou encore leur solitude dans Tout seul (2014). Les évocations naïves, maladroites ou fragiles, les collages, les dessins rendent compte de la diversité des expériences subjectives mais aussi de l’imagination artistique des enfants. Réalisé dans le cadre de« Petites histoires en noir et blanc » et coordonné par Caroline Nugues et Marie Vella, Va dans ta chambre (2009) est probablement un des exemples les plus poétiques de cette série ; la voix des enfants évoque le sentiment des enfants relégués dans leurs chambres, trop petits encore pour accéder aux secrets des adultes qui les tiennent à l’écart. La porte devient le passage obligé pour approcher la connaissance et la clé, image récurrente, est à la fois celle de la libération mais aussi l’objet qui mène inéluctablement à l’âge adulte. Mais loin de se limiter aux enfants, d’autres publics et d’autres thématiques alimentent aussi cette lignée ; l’impact de témoignages oraux vient aussi structurer La débrouille au quotidien (issu d’un atelier d’animation mené par Delphine Cousin et Delphine Renard en 2010 avec des participants répondant à l’article 27). Des films de l’Atelier Collectif explorent également cette interaction possible ; dans Des cailloux plein les poches (réalisé en 2009 avec Camera-etc), les clichés d’enfance des réalisateurs déclenchent les souvenirs racontés par les cinéastes mais aussi, du point de vue esthétique, l’hybridité visuelle, entre animation et photographies. Plus qu’évoqués, les souvenirs des faits et des états, mais aussi les sensations, les odeurs, les parfums sont incarnés comme autant de micro-mondes, rendant compte de la diversité des expériences et des esthétiques, chaque réalisateur investissant son propre passé par les caractéristiques de son trait ou de sa technique.

Aral, Delphine Renard et Delphine Cousin (2009)
Aral de Delphine Renard et Delphine Cousin (2009) s’éloigne partiellement de cette hybridité visuelle pour revenir à une forme d’animation en apparence plus traditionnelle même si elle combine dessins et collages. Pourtant, les deux réalisatrices inscrivent ce récit de quelques habitants relégués dans un univers désolé, saturé de sable et où la mer a disparu, dans une perspective historique, celle de la mer d’Aral. Passé, présent, souvenirs et fantasmes coexistent dans les plans avec, comme un rappel insistant, l’univers aquatique qui ressurgit sans cesse dans les décors, dans les esprits, pour enfin s’inscrire dans le réel des personnages (les deux enfants et le père de l’un d’entre eux) qui retrouvent la pêche dans un ailleurs ostensiblement idyllique. Réalisé en animation de volume et plus spécifiquement en objets recyclés pour les personnages, Kin (2011) s’ancre cette fois dans une réalité non pas historique, mais bien terriblement actuelle ; celle d’un quartier populaire de Kinshasa où se croisent un chauffeur de taxi, un policier, une ‘mama’, un garagiste. Si« on y décrit sans fard, la misère, la corruption endémique et la grande débrouille qui y caractérise la vie à Kinshasa »[14], le film insuffle une veine humoristique qui vient, comme les figurines recyclées, dynamiser le paysage et la narration.
Dans un style radicalement différent, les films de Noémie Marsily et Carl Roosens frappent par leur unicité et leur personnalité enlevée. Après les tribulations genrées de Caniche (2010) ou l’humour corrosif des morts successives de Moustique (2014) dans les 6 épisodes de la série, Noémie Marsily et Carl Roosens choisissent d’entraîner les spectateurs dans une ritournelle obsédante et absurde, tant sur le plan musical que visuel, avec Autour du lac (2013). Sur la voix de Carl Roosens qui chante d’une voix tonitruante sa marche autour du lac, la progression effective de son alter-égo et les personnages qu’il croise, les dessins tremblants et extrêmement colorés saisissent personnages, animaux et paysages dans des saynètes à l’humour mordant et rythmées par les vibrations sourdes des trompettes; seul le personnage masculin poursuit sa route jusqu’à un éclatement psychédélique des formes et des couleurs puis le retour au calme et au canard seul sur le lac qui finit par reprendre son vol. Je ne sens plus rien (2016) témoigne à son tour de la création d’une mythologie profondément personnelle qui passe par les traits fouillis, la narration explosive et les personnages déjantés du magicien au don d’invisibilité, de la femme-pompier et de deux créatures-ogresses.

Kijé, Joanna Lohro (2014)
Véritable fulgurance visuelle et symbolique, Kijé de Joanna Lorho (2014) embarque le spectateur pour un rite initiatique transcendent, du crépuscule à l’aube. Coproduit par l’atelier Graphoui, le projet entre littéralement dans l’idée d’un récit mythologique, tout en gardant une identité profondément personnelle exprimée, encore une fois, par le trait caractéristique de Lohro ; un homme plongé dans la solitude d’une ville aux relents industriels se réveille un soir pour découvrir un cortège hallucinant d’une légion de personnages et d’animaux inimaginables, vision contemporaine de l’imagerie d’un Jérôme Bosch, qui l’entraînent loin de l’urbain, au cœur des arbres et au sommet d’une colline. Emmené, dépouillé de ses vêtements, mis à nu dans tous les sens du terme, l’homme est affublé d’une tête de dieu-cerf, symbole d’une mythologie païenne, et porté pour vivre le rite final. La fragilité apparente d’un trait pris d’un constant frémissement, l’univers laiteux aux infinies variations de noirs, blancs et gris, la quasi transparence des personnages et des créatures qui peuplent le film dans une longue procession, participent à ce passage d’un univers condamné à la luminosité d’une nouvelle aube naissante. Joanna Lorho met ici en scène les figures frappantes et cosmiques de sa propre mythologie, révélant le pouvoir de l’imaginaire dans la réinvention d’une humanité qui aurait perdu (presque) tout espoir. La métaphore du cinéma comme déclencheur d’un réveil possible n’est pas loin, au travers de l’image des créatures qui éclairent de façon intermittente les immeubles de leur corps lumineux et réveillent l’homme de son sommeil et de son inertie pour finalement le pousser à revenir au mouvement.

De longues vacances, Caroline Nugues (2015)
Comme un très lointain écho aux créatures mythologiques de Joanna Lorho, le deuxième film de Caroline Nugues, De longues vacances, met lui aussi en scène une figure mythique. Mais comme bon nombre d’exemples déjà cités, il ancre son récit dans des racines réelles et trouve ses origines dans un atelier mené en 2011 avec des enfants sur la question de l’identité et du travail, mais aussi de la place de chacun dans la société. Le film dépeint les vacances d’une petite fille, Louise, et de ses parents ; entre ces derniers, la tension est palpable et la situation du père sans travail extrêmement précaire. Le soir, le père raconte l’histoire de la sirène Helga qui chantait faux, qui pousse Louise à se mettre en quête d’objets appartenant au personnage mythique. La sirène devient l’alter égo, le monde des possibles, l’ailleurs et l’autre dans lequel se réfugier ; celle qui l’emmène dans son univers imaginaire, loin des disputes de ses parents. Mais le destin d’Helga est de s’effacer (dans le récit, après avoir déclenché une grosse vague pour libérer les poissons, elle disparaît), comme l’enfance et l’innocence de Louise au départ de la caravane vers des préoccupations du quotidien. Dans le récit mis en place par Caroline Nugues, chacun a sa place ; là où le père invente, la mère s’ancre dans un pragmatisme terre à terre et Louise s’échappe au travers de son double imaginaire. Investis à hauteur d’enfant, la narration oscille constamment et l’animation permet la porosité des frontières entre la réalité difficile des parents et l’imaginaire de Louise qui se déclenche au détour des objets trouvés et du récit du père. L’identité complexe, novatrice, de ces films renvoie à l’identité plurielle de leurs auteurs. Mais au-delà de ce constat et loin de représenter des formes hermétiques, ces œuvres et ces artistes, dans l’exposition de leurs mythologies personnelles, engagent également les spectateurs. Comme le souligne encore une fois Jean-Jacques Wunenburger,« l’imaginaire peut accéder à une quasi-universalité, surtout sous forme d’images visuelles, traversant les frontières culturelles, sans que cette invariance puisse être rattachée à un simple effet de diffusion .[15]
C’est finalement l’effet de ces univers personnels démultipliés ; dans un accroissement de sens, ils entraînent les spectateurs à s’y reconnaître, à s’y retrouver – même s’ils leur sont étrangers au départ et si les formes qu’ils affichent ne sont pas celles de leurs propres imaginaires. Car, au travers de leurs formes et de leurs personnalités plastiques, ils les poussent également à se repositionner, à se redéfinir à leur tour, dérangeant souvent leurs attentes vis-à-vis de la perception même de ces films qui dépassent de loin le seul cadre du cinéma d’animation. L’identité du regardant lui-même, la rencontre avec ses propres mythologies, doit finalement être reconsidérée, prise dans le jeu des frontières malléables de l’image en mouvement, forcément nomades ou en perpétuelle métamorphoses.
[1] Dick Tomasovic, « Ré-animer l’histoire du cinéma (quand l’animatographe explore le cinématographe » dans Cinémas, « Histoires croisées des images. Objets et méthodes, vol.14, n°2-3, Printemps 2004. URI : id.erudit.org/iderudit/026006ar
[2] « Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française relatif à l’agrément et au subventionnement des ateliers de production et d’accueil en matière de films et de vidéogrammes”, publié au Moniteur belge le 28 Novembre 1990.
[3] R. Canudo, “Esthétique du Septième Art (II). Le drame visuel” (1921) et “L’art pour le septième art” (1921), cités par Laurent Guido dans “Le film comme ‘art plastique en mouvement’ dans les premières théories françaises du cinéma”, dans CinémAction « Arts plastiques et cinéma » dirigé par Sébastien Denis, Corlet Publications, 2007, p.85.
[4] Boris Eichenbaum, “Problèmes de Ciné-Stylistique” (1926) dans Les formalistes russes et le cinéma – Poétique du film, sous la direction de François Albéra, Paris : Nathan, 1993, p.40
[5] Angela Della Vache, Cinema & Painting – How Art is used in film, Austin: University of Texas Press, 1996, p.3 (traduction de l’auteure).
[6] Silvestra Mariniello, « Médiation et intermédialité » dans « Inter média – Littérature, cinéma et intermédialité », Paris : L’Harmattan, 2011 ; la définition avait été proposée au premier colloque international du Centre de recherche sur l’intermédialité, Montréal, Mars 1999.
[7]Zorobabel, 20 ans, 1994-2014, Bruxelles: Zorobabel, p. 8.
[8] Isabelle De Maison Rouge, Mythologies personnelles, l’art contemporain et l’intime, Editions Scala, Paris, 2004, p.6.
[9] Isabelle De Maison Rouge, op.cit., p.17.
[10] Isabelle De Maison Rouge, op.cit., p.19.
[11]Zorobabel 1994-2014, p.45.
[12] Jean-Jacques Wunenburger, L’imaginaire, Paris: Presses Universitaires de France, 2003, p.5.
[13] Idem.
[14] Marceau Verhaeghe, “Kin, de Daniel Colin” dans Cinergie, Webzine n°159, Avril 2011.
[15] Jean-Jacques Wunenburger, op.cit., p.6.